septembre 2025
Tempête sur le cerveau
Les conséquences de l'utilisation de l'outil digital sur l'être humain ? Thierry Derez et Marc Tadié font le point sur l'état des connaissances et publient "Le Cerveau sans mémoire – Un tsunami nommé smartphone".
Le smartphone et le cerveau. Une vieille histoire qui a commencé par des interrogations sur les effets des ondes sur le cerveau et le corps. On n’en est plus là : désormais, c’est l’utilisation intensive qui questionne. On parle de conséquences sur le sommeil (en quantité et en qualité) et la concentration, de problèmes liés à la sédentarité et à l’addiction, d’isolement et de « déficience émotionnelle », de troubles de l’attention et d’irritabilité accrue. Au point que le 4 septembre, une commission d’enquête de l’Assemblée nationale a publié un rapport alarmant sur les effets psychologiques de TikTok chez les mineurs, les contenus toxiques proposés ajoutant leurs effets aux précités.
Même sans aller jusqu’à l’addiction, la dépendance excessive – et devenue le cas pour la majorité des utilisateurs, c’est-à-dire tout le monde, - suscite des interrogations. Dans Le Cerveau sans mémoire – Un tsunami nommé smartphone, le neurochirurgien Marc Tadié et son coauteur Thierry Derez, président du conseil d'administration du groupe Covéa, alertent sur les dangers de l'utilisation immodérée du « téléphone intelligent » en s'appuyant sur les dernières découvertes de l’imagerie cérébrale. Et en reconnaissant que « le smartphone est un outil merveilleux, mais qui ne doit pas nous tenir en laisse ». Il est scientifiquement avéré que le smartphone modifie l’activité cérébrale, phénomène qui s’accentue avec les développements de l’IA dont les deux auteurs traitent finalement autant que du smartphone.
Il ne s’agit plus seulement de baisse de concentration chez les plus jeunes ou de fatigue mentale liée à la surstimulation électronique, mais bien de modification du cerveau. Avec le Gps, plus besoin des étoiles, de sens de l’orientation ou de carte, « mais en confiant de multiples activités cérébrales au smartphone, il est avéré que le cerveau s’atrophie, le volume de la matière grise diminue ». Le contenu de Google permet de ne plus apprendre par coeur, mais en contrepartie, « ce sont des kilomètres de réseaux de neurones qui ne se développent pas ». En résumé, « l’outil digital met notre cerveau en péril, que ce soit en agissant directement sur le cerveau (atrophie des circuits et diminution des corps cellulaires) ou bien par les modifications de nos comportements, les deux facteurs étant liés et interagissant l’un sur l’autre ».
Les deux auteurs proposent une analyse très abordable et pédagogue, basée sur des explications scientifiques étayées d’exemples et d’anecdotes, non sans humour. Dix parties abordent aussi bien le fonctionnement du cerveau, de l’hippocampe, de l’amygdale et l’histoire de la recherche à son sujet, que l’état des connaissances sur la mémoire et la conservation des souvenirs ou encore l’évolution de l’humanité à travers ses progrès techniques. Ils notent au passage que si les précédents visaient à alléger les difficultés physiques, celle-là se propose de délester le cerveau. Un « changement de paradigme tient à ce que la machine, jusqu’alors circonscrite au domaine de l’effort physique, s’attaque depuis peu, mais avec une fulgurante rapidité, aux fonctions mentales de l’être humain. »
Cerveau et mémoire
« La mémorisation automatique, facilitée par son smartphone, s’est substituée de façon insidieuse à notre mémoire. La mémoire naturelle étant le support de notre personnalité, l’automatiser est le début de sa délégation à l’outil digital. » Mémoire et intelligence étant interconnectés et s’influençant l’une l’autre, doit-on céder à la machine le dernier sanctuaire de la spécificité humaine, l’intelligence ? demandent-ils.
Si « Google est devenu la mémoire de notre absence de savoir », tout n’est cependant pas négatif. En se basant encore une fois sur des données scientifiques, les auteurs affirment que si l’utilisation du digital et du smartphone n’est pas recommandé pour les enfants, ils estiment qu’un apport bénéfique existe, notamment pour les personnes âgées.
De ce point de vue, ils pointent un paradoxe : « Si le spectre d’avoir la maladie d’Alzheimer, et donc de perdre la mémoire, est la hantise de tout un chacun, personne en revanche ne semble se préoccuper d’un plus grand danger encore méconnu : déléguer sa mémoire à l’outil digital. Progressivement, insidieusement, celui-ci vide notre cerveau de la substance sur laquelle repose notre personnalité, notre intelligence et notre imagination. Il est devenu d’autant plus dangereux qu’il est séduisant et incontournable. Incontournable, car utilisé pour une myriade d’actes de la vie courante ; séduisant, car ludique et économe de nos efforts. Toutefois, le péril pour notre cerveau est bien réel. Des preuves issues des travaux scientifiques de plus en plus nombreux démontrent que notre cerveau s’atrophie à force de déléguer sa mémoire à l’outil digital. »
Plus loin, ils ajoutent que « l’intelligence artificielle est un outil qui ne doit devenir prothèse que pour les personnes handicapées, déficientes ou âgées. Elle constitue alors une ressource prodigieuse. Cette jeune science mérite une éthique d’utilisation aux antipodes de ce que risque d’en faire la paresse. » Car il semblerait que « l’utilisation inconsidérée de ces nouveaux serviteurs provoque au jeune âge des lésions potentiellement irréversibles. Arrivant à point nommé, l’intelligence artificielle est considérée comme capable de combler ces dégâts. Le prix à payer ? L’abandon de notre personnalité via la disparition de notre mémoire et l’atrophie du cerveau. »
Les deux auteurs abordent leur sujet de différentes manières : scientifique, historique, sociologique, biologique et philosophique. « Depuis le développement de l’informatique, qui repose justement sur la prodigieuse mémoire de l’ordinateur, cette fonction cérébrale ne semble plus préoccuper que les sujets âgés. Depuis quelques années, il semble que cette fonction primordiale du cerveau humain, sur laquelle se fondent les cinq sens, ne soit plus d’actualité. Pourtant, la mémoire demeure le support de notre personnalité, le tremplin de l’imagination, de notre liberté, et cela sans parler de culture, de connaissance, de civilisation. »
Tous ces « risques pour le développement physique et psychique » et l’éventualité de tomber dans un « comportement addictif typique » peuvent être évités par le contrôle, la maîtrise et une utilisation modérée.
Même sans aller jusqu’à l’addiction, la dépendance excessive – et devenue le cas pour la majorité des utilisateurs, c’est-à-dire tout le monde, - suscite des interrogations. Dans Le Cerveau sans mémoire – Un tsunami nommé smartphone, le neurochirurgien Marc Tadié et son coauteur Thierry Derez, président du conseil d'administration du groupe Covéa, alertent sur les dangers de l'utilisation immodérée du « téléphone intelligent » en s'appuyant sur les dernières découvertes de l’imagerie cérébrale. Et en reconnaissant que « le smartphone est un outil merveilleux, mais qui ne doit pas nous tenir en laisse ». Il est scientifiquement avéré que le smartphone modifie l’activité cérébrale, phénomène qui s’accentue avec les développements de l’IA dont les deux auteurs traitent finalement autant que du smartphone.
Il ne s’agit plus seulement de baisse de concentration chez les plus jeunes ou de fatigue mentale liée à la surstimulation électronique, mais bien de modification du cerveau. Avec le Gps, plus besoin des étoiles, de sens de l’orientation ou de carte, « mais en confiant de multiples activités cérébrales au smartphone, il est avéré que le cerveau s’atrophie, le volume de la matière grise diminue ». Le contenu de Google permet de ne plus apprendre par coeur, mais en contrepartie, « ce sont des kilomètres de réseaux de neurones qui ne se développent pas ». En résumé, « l’outil digital met notre cerveau en péril, que ce soit en agissant directement sur le cerveau (atrophie des circuits et diminution des corps cellulaires) ou bien par les modifications de nos comportements, les deux facteurs étant liés et interagissant l’un sur l’autre ».
Les deux auteurs proposent une analyse très abordable et pédagogue, basée sur des explications scientifiques étayées d’exemples et d’anecdotes, non sans humour. Dix parties abordent aussi bien le fonctionnement du cerveau, de l’hippocampe, de l’amygdale et l’histoire de la recherche à son sujet, que l’état des connaissances sur la mémoire et la conservation des souvenirs ou encore l’évolution de l’humanité à travers ses progrès techniques. Ils notent au passage que si les précédents visaient à alléger les difficultés physiques, celle-là se propose de délester le cerveau. Un « changement de paradigme tient à ce que la machine, jusqu’alors circonscrite au domaine de l’effort physique, s’attaque depuis peu, mais avec une fulgurante rapidité, aux fonctions mentales de l’être humain. »
Cerveau et mémoire
« La mémorisation automatique, facilitée par son smartphone, s’est substituée de façon insidieuse à notre mémoire. La mémoire naturelle étant le support de notre personnalité, l’automatiser est le début de sa délégation à l’outil digital. » Mémoire et intelligence étant interconnectés et s’influençant l’une l’autre, doit-on céder à la machine le dernier sanctuaire de la spécificité humaine, l’intelligence ? demandent-ils.
Si « Google est devenu la mémoire de notre absence de savoir », tout n’est cependant pas négatif. En se basant encore une fois sur des données scientifiques, les auteurs affirment que si l’utilisation du digital et du smartphone n’est pas recommandé pour les enfants, ils estiment qu’un apport bénéfique existe, notamment pour les personnes âgées.
De ce point de vue, ils pointent un paradoxe : « Si le spectre d’avoir la maladie d’Alzheimer, et donc de perdre la mémoire, est la hantise de tout un chacun, personne en revanche ne semble se préoccuper d’un plus grand danger encore méconnu : déléguer sa mémoire à l’outil digital. Progressivement, insidieusement, celui-ci vide notre cerveau de la substance sur laquelle repose notre personnalité, notre intelligence et notre imagination. Il est devenu d’autant plus dangereux qu’il est séduisant et incontournable. Incontournable, car utilisé pour une myriade d’actes de la vie courante ; séduisant, car ludique et économe de nos efforts. Toutefois, le péril pour notre cerveau est bien réel. Des preuves issues des travaux scientifiques de plus en plus nombreux démontrent que notre cerveau s’atrophie à force de déléguer sa mémoire à l’outil digital. »
Plus loin, ils ajoutent que « l’intelligence artificielle est un outil qui ne doit devenir prothèse que pour les personnes handicapées, déficientes ou âgées. Elle constitue alors une ressource prodigieuse. Cette jeune science mérite une éthique d’utilisation aux antipodes de ce que risque d’en faire la paresse. » Car il semblerait que « l’utilisation inconsidérée de ces nouveaux serviteurs provoque au jeune âge des lésions potentiellement irréversibles. Arrivant à point nommé, l’intelligence artificielle est considérée comme capable de combler ces dégâts. Le prix à payer ? L’abandon de notre personnalité via la disparition de notre mémoire et l’atrophie du cerveau. »
Les deux auteurs abordent leur sujet de différentes manières : scientifique, historique, sociologique, biologique et philosophique. « Depuis le développement de l’informatique, qui repose justement sur la prodigieuse mémoire de l’ordinateur, cette fonction cérébrale ne semble plus préoccuper que les sujets âgés. Depuis quelques années, il semble que cette fonction primordiale du cerveau humain, sur laquelle se fondent les cinq sens, ne soit plus d’actualité. Pourtant, la mémoire demeure le support de notre personnalité, le tremplin de l’imagination, de notre liberté, et cela sans parler de culture, de connaissance, de civilisation. »
Tous ces « risques pour le développement physique et psychique » et l’éventualité de tomber dans un « comportement addictif typique » peuvent être évités par le contrôle, la maîtrise et une utilisation modérée.
Le Cerveau sans mémoire. Un tsunami nommé smartphone par Thierry Derez et Marc Tadié. 240 p., édition du Cherche Midi, 19,80 euros.
L'addiction aux jeux vidéos est pour l'instant la seule reconnue comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Les autres formes de dépendance au numérique, de l'attachement à l'objet au besoin de consultation et à l"usage intensif sont classés dans différentes catégories de troubles du comportement comme l'anxiété ou les comportements compulsifs. A noter que l'isolement social peut-être cause, conséquence et/ou symptôme de la dépendance au numérique. Selon des chercheurs, l'usage du smartphone ne serait pas à négliger dans les problèmes de santé mentale lors de la période Covid.
articles
- • Une maison aux portes grandes ouvertes
- • Echanges d’amitiés
- • Cassures
- • Festival des solutions écologiques 2026 : à toi de jouer !
- • Banque Populaire lance EXTRA +X, son nouveau programme de fidélité exclusif pour ses sociétaires et clients
- • « Il est avéré que le smartphone a des effets sur le tissu cérébral »
- • Accompagnateur de la vie étudiante
- • La restauration au coeur du bien-être
- • Zone zen sur le campus
- • A l’oeuvre pour la vie de campus
express
Pédagogie numérique
avril 2020
Digischool, l’Afpa et La Poste ont créé l’appli pédagogique gratuite Super Cléa Num qui facilite l’acquisition de compétences numériques. En confinement, le numérique devient plus indispensable que jamais, or, 17 % de la population manque de compétences numériques selon une étude de l'Insee. Super Cléa Num est un parcours d’entraînement personnalisé permettant d’acquérir des compétences numériques. S’appuyant sur l’expertise de l’AFPA dans la formation des publics éloignés du numérique, "les contenus d’entrainement répondent à des objectifs concrets d’acquisition de connaissances et de progression dans les usages numériques, en situation de travail et pour la vie quotidienne tels que protéger ses données, sécuriser son ordinateur, réaliser un CV, utiliser les suites bureautiques." Accessible gratuitement à partir d’un smartphone ou d’une tablette (sous Android et IOS) en téléchargeant l’application sur cleanum.fr/applications/
Smartphone
janvier 2020
Selon une enquête OpinionWay pour Heyme de juin 2019, 23 % des étudiants passent plus de 6 h par jour sur leur smartphone et 85 % y passent au moins 2 h par jour. 38 % se disent incapables de se passer de leur smartphone pendant une journée. Selon le porte-parole de cette mutuelle santé destinée aux jeunes «la consultation du smartphone commence dès le saut du lit pour la majorité des étudiants mais également pour une grande partie de la population ! Quand on sait que les écrans impactent fortement notre concentration, notre qualité de sommeil et favorisent l'apparition de maux de têtes et de douleurs oculaires, il nous parait indispensable de prévenir, sensibiliser et éduquer les jeunes et la sphère éducative sur les bonnes pratiques liées au digital».
Phishing
avril 2019
Le phishing ou hameçonnage sur internet continue de faire rage. Tous les prétextes sont bons, à l'exemple de la série "Game of thrones" dont le nombre de fans a attiré les esprits malintentionnés (proposant par exemple de faire gagner des coffrets et cadeaux de la série dans le but de récupérer adresses mails, numéros de téléphones voire de cartes bancaires). Petit rappel de quelques précautions : on peut cliquer sur des liens à partir de sites web de confiance. Mais les liens qui apparaissent dans des emails et des messages instantanés inconnus ne mènent généralement pas à des destinations sûres. S'assurer que l'URL d'un site commence par « https » et qu'une icône représentant un verrou fermé est bien présente près de la barre d'adresse. Vérifier que le nom de domaine du site correspond exactement à celui que vous souhaitez consulter et auquel vous faites confiance. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez être sur le point de devenir la prochaine victime d'une escroquerie par phishing. Disposer d’une solution avancée de prévention des menaces, notamment celles contenant la protection zero-phishing.
Cybersécurité
juin 2018
Un Mooc gratuit pour connaître les base de la cybersécurité : créé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, il permet de s'initier ou d'approfondir des connaissances pour protéger ses outils numériques. En ligne jusqu'en avril 2019 ici.
Le savez-vous ?
décembre 2017
80 % des 11 – 17 ans vont sur internet au moins une fois par jour
Voir tout

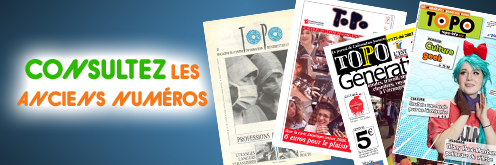
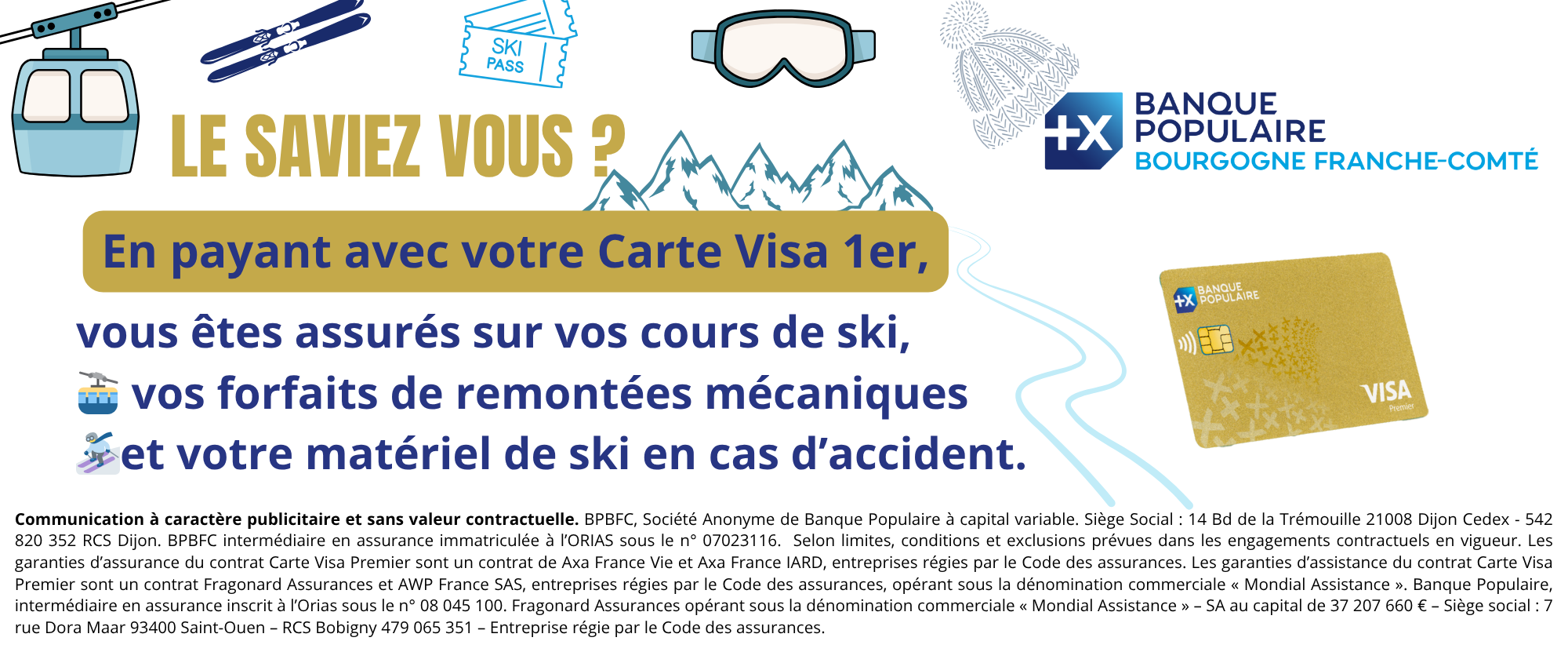



Commentaires
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.