septembre 2022
Des réserves pour conserver la nature
Depuis 1976, elles accomplissent un important travail de protection et de gestion des milieux naturels. Visite à Cléron, dans l’une des 169 réserves nationales, qui s’est notamment spécialisée dans l’observation des invertébrés.
Photo Laurent Cheviet
Dominique Langlois arpente la réserve naturelle de Valbois depuis 1992. Il connaît bon nombre de recoins de cet espace de 234 ha, du fonds du ravin à la falaise le surplombant de 210 m. Un espace qui entaille le premier plateau du Jura, où plus de 6000 espèces végétales et animales ont été dénombrées et qui rassemble une grande diversité de milieux entre éboulis, forêts, ruisseau et même certains éléments de milieu méditerranéen, lié à l’orientation de la falaise. « C’est une très forte concentration de biodiversité sur un petit espace » assure le conservateur de la réserve naturelle nationale du ravin de Valbois.
Celle-ci est l’une des 169 créées en France – dont 11 en Bourgogne-Franche-Comté. Le projet est porté depuis 1983 par la faculté des sciences de Besançon et géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté dont Dominique Langlois est l’un des 35 salariés. Même si la première réserve naturelle date de 1961, c’est une loi de 1976 qui a posé les bases de ces espaces protégés. « La demande était de créer des structures pour gérer les milieux remarquables résume Dominique Langlois, mais au-delà, on essaie de créer une assise citoyenne et un lien avec la population ». Pédagogie et sensibilisation sont les marqueurs de ce lien, dont on trouve des éléments à la maison de la réserve à Cléron ou encore à celle du lac de Rémoray, avec son espace d’exposition pédagogique. Sorties, conférences, expos et autres animations font partie des activités du Conservatoire d’espaces naturels.
Six ânes pour l'entretien
Mais le principal reste la protection du milieu, ce qui n’est pas toujours simple. « Il y a quelques années, il a été question d’un projet de piste de décollage dans la réserve ! Faire abandonner cette idée a été très compliqué » se suvient Dominique Langlois. La présence et l’intervention humaine doivent être minimales. L’accès au ravin est libre jusqu’à 9 personnes ; au-delà, il faut une autorisation préfectorale. Gérer le lieu passe, la plupart du temps, par la non-intervention, mais c’est surtout un équilibre à trouver. « Quand on a créé la réserve, l’enfrichement n’a pas été anticipé explique par exemple Dominique Langlois. Alors il a fallu défricher et remettre en pâturage. On a installé des ânes pour assurer l’entretien. » Au nombre de 6, ces derniers se promènent sur la corniche. Ils font partie du compromis exploitation/non-exploitation qui découle d’un choix de gestion issu également de discussion avec le propriétaire privé qui détient une partie de la réserve. La concertation avec les acteurs locaux est inscrite dans la définition des réserves.
Chaque réserve ayant ses spécificités, sa gestion est liée à sa connaissance fine, ce qui implique une certaine latitude laissée à chacun. A Valbois, au fil du temps, on s’est spécialisé dans l’étude de la faune des sols. Une fois par mois, de mars à octobre, 13 stations permettent de récolter les invertébrés du ravin et d’obtenir un échantillonnage conséquent (lire aussi). « Ces relevés suivent un protocole pointu non seulement pour connaître ce qui existe mais aussi pour que cela soit reproductible et permette la comparaison dans plusieurs années. Pour avoir des tendances, il faut du long terme, avec le même protocole. Pour ce travail, on coopère avec d’autres sites à l’échelle européenne. » La réserve du ravin s’est plus précisément spécialisée sur les diptères (insectes à une paire d’ailes comme les mouches). Ce travail est effectué à des fins de connaissance mais aussi de distinction des espèces menacées.
Insectes indicateurs de l'environnement
Ce programme d’étude de la biodiversité à partir des insectes est rare. « Peu de réserves sont connues pour ça. En général, une réserve naturelle est plutôt créée sur une base floristique ou ornithologique. Certains groupes d’invertébrés sont très peu connus mais il y a de plus en plus de spécialistes ajoute Dominique Langlois. Ce n’est pas anodin : les insectes sont importants pour l’équilibre et la fertilité des sols et sont de très bons indicateurs de l’environnement, notamment parce qu’il existe de très nombreuses espèces. Les mille-pattes sont par exemple utiles pour connaître l’état des sols. Les syrphes sont un bon indicateur de l’état des forêts. On peut aussi évaluer les cours d’eau à partir des insectes. En 2013, après la première canicule, les espèces « spécialisées » ici ont mis 5 ans à revenir. »
Comme beaucoup de ceux qui travaillent dans l’environnement, Dominique Langlois se désole de l’état des lieux actuels. Un brin fataliste devant « le changement colossal qui nous attend », il trouve une motivation dans l’idée de faire avancer la connaissance. « Décrire de nouvelles espèces de diptères, c’est quelque chose qui me plaît beaucoup »
Stéphane Paris.
Celle-ci est l’une des 169 créées en France – dont 11 en Bourgogne-Franche-Comté. Le projet est porté depuis 1983 par la faculté des sciences de Besançon et géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté dont Dominique Langlois est l’un des 35 salariés. Même si la première réserve naturelle date de 1961, c’est une loi de 1976 qui a posé les bases de ces espaces protégés. « La demande était de créer des structures pour gérer les milieux remarquables résume Dominique Langlois, mais au-delà, on essaie de créer une assise citoyenne et un lien avec la population ». Pédagogie et sensibilisation sont les marqueurs de ce lien, dont on trouve des éléments à la maison de la réserve à Cléron ou encore à celle du lac de Rémoray, avec son espace d’exposition pédagogique. Sorties, conférences, expos et autres animations font partie des activités du Conservatoire d’espaces naturels.
Six ânes pour l'entretien
Mais le principal reste la protection du milieu, ce qui n’est pas toujours simple. « Il y a quelques années, il a été question d’un projet de piste de décollage dans la réserve ! Faire abandonner cette idée a été très compliqué » se suvient Dominique Langlois. La présence et l’intervention humaine doivent être minimales. L’accès au ravin est libre jusqu’à 9 personnes ; au-delà, il faut une autorisation préfectorale. Gérer le lieu passe, la plupart du temps, par la non-intervention, mais c’est surtout un équilibre à trouver. « Quand on a créé la réserve, l’enfrichement n’a pas été anticipé explique par exemple Dominique Langlois. Alors il a fallu défricher et remettre en pâturage. On a installé des ânes pour assurer l’entretien. » Au nombre de 6, ces derniers se promènent sur la corniche. Ils font partie du compromis exploitation/non-exploitation qui découle d’un choix de gestion issu également de discussion avec le propriétaire privé qui détient une partie de la réserve. La concertation avec les acteurs locaux est inscrite dans la définition des réserves.
Chaque réserve ayant ses spécificités, sa gestion est liée à sa connaissance fine, ce qui implique une certaine latitude laissée à chacun. A Valbois, au fil du temps, on s’est spécialisé dans l’étude de la faune des sols. Une fois par mois, de mars à octobre, 13 stations permettent de récolter les invertébrés du ravin et d’obtenir un échantillonnage conséquent (lire aussi). « Ces relevés suivent un protocole pointu non seulement pour connaître ce qui existe mais aussi pour que cela soit reproductible et permette la comparaison dans plusieurs années. Pour avoir des tendances, il faut du long terme, avec le même protocole. Pour ce travail, on coopère avec d’autres sites à l’échelle européenne. » La réserve du ravin s’est plus précisément spécialisée sur les diptères (insectes à une paire d’ailes comme les mouches). Ce travail est effectué à des fins de connaissance mais aussi de distinction des espèces menacées.
Insectes indicateurs de l'environnement
Ce programme d’étude de la biodiversité à partir des insectes est rare. « Peu de réserves sont connues pour ça. En général, une réserve naturelle est plutôt créée sur une base floristique ou ornithologique. Certains groupes d’invertébrés sont très peu connus mais il y a de plus en plus de spécialistes ajoute Dominique Langlois. Ce n’est pas anodin : les insectes sont importants pour l’équilibre et la fertilité des sols et sont de très bons indicateurs de l’environnement, notamment parce qu’il existe de très nombreuses espèces. Les mille-pattes sont par exemple utiles pour connaître l’état des sols. Les syrphes sont un bon indicateur de l’état des forêts. On peut aussi évaluer les cours d’eau à partir des insectes. En 2013, après la première canicule, les espèces « spécialisées » ici ont mis 5 ans à revenir. »
Comme beaucoup de ceux qui travaillent dans l’environnement, Dominique Langlois se désole de l’état des lieux actuels. Un brin fataliste devant « le changement colossal qui nous attend », il trouve une motivation dans l’idée de faire avancer la connaissance. « Décrire de nouvelles espèces de diptères, c’est quelque chose qui me plaît beaucoup »
Stéphane Paris.
Les actions des réserves naturelles s'articulent autour de trois notions principales : protéger, gérer, sensibiliser. D’après le site de Réserves naturelles de France, grâce à une réglementation adaptée respectant le contexte local, leur champ d'intervention est large :
préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition ou remarquables, reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats, conservation des jardins botaniques et arboretum constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables, préservation des biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables, préservation ou constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage, études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines, préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de la vie et des premières activités humaines.
reserves-naturelles.org
Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation.
Il en existe actuellement 169 dont 11 en BFC (Ballons comtois, bois du Parc, combe Lavaux - Jean Roland, grotte de Gravelle, grotte du Carroussel, Île du Girard, la Truchère-Ratenelle, lac de Remoray, ravin de Valbois, sabot de Frotey, val de Loire).
Elles présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves nationales, mais elles sont créées par les Régions, constituant un vecteur des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires.
Il y en a actuellement 181 dont 19 en BFC.
articles
- • Une maison aux portes grandes ouvertes
- • Echanges d’amitiés
- • Cassures
- • Festival des solutions écologiques 2026 : à toi de jouer !
- • Banque Populaire lance EXTRA +X, son nouveau programme de fidélité exclusif pour ses sociétaires et clients
- • « Il est avéré que le smartphone a des effets sur le tissu cérébral »
- • Accompagnateur de la vie étudiante
- • La restauration au coeur du bien-être
- • Zone zen sur le campus
- • A l’oeuvre pour la vie de campus
express
Biodiversité
janvier 2026
En savoir plus sur la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté ? L'Agence régionale biodiversité est là pour vous informer. Elle a notamment publié un état des lieux référence en 2022, en livret et en numérique, avec 100 chiffres expliqués autour de 4 thématiques : les espèces présentes, leur répartition, leur évolution, leur état (liste rouge, espèces protégées). Disponible ici.
Impact carbone
avril 2025
Un nouveau simulateur mis en ligne par l'Ademe permet de calculer l'empreinte carbone d'une livraison de colis. Sans surprise, c'est l'achat en magasin de proximité qui génère le moins d'impact. C'est le 14e calculateur de ce type proposé par l'agence de la transition écologique. Ils sont en ligne ici.
Espèces menacées
mars 2025
Pour mieux sensibiliser à la biodiversité et aux espèces menacées, France Info a créé un site avec moteur de recherche par région. En Bourgogne-Franche-Comté, 957 espèces sont menacées ; certaines en danger critique comme la déesse précieuse (une libellule), l'hydne corail (un champignon) ou le râle des genêts (un oiseau).
Tabac et environnement
novembre 2024
Selon l’Organisation mondiale de la santé, la production annuelle de gaz à effet de serre par l’industrie du tabac s’élève à 84 mégatonnes d’équivalent dioxyde de carbone, soit 1/5e de de celle de l’industrie du transport aérien. Elle correspond au lancement de 280 000 fusées. Elle utilise également 22 milliards de tonnes d’eau. Son impact sur le changement climatique n’est donc pas négligeable. D'après l'organisme, « les produits du tabac représentent les principaux déchets sur la planète, et contiennent plus de 7000 produits chimiques toxiques, qui pénètrent dans notre environnement lorsqu’ils sont jetés. Environ 4500 milliards de filtres à cigarettes polluent océans, fleuves, trottoirs, parcs, sols et plages chaque année ». Finalement, fumer a plus d’impact négatif sur la planète que manger de la viande rouge.
Pitch your project 2024
septembre 2024
Un concours ouvert aux 16 - 29 ans destiné à renforcer l’attractivité et de développement durable de la région alpine. Il s'agit d'avoir une idée pour les Alpes et de vouloir la concrétiser et échanger avec des jeunes de toute la région alpine. Quatre thèmes sont proposés : gestion durable de l'eau, économie circulaire, participation des jeunes, mobilité. Ce concours peut être réalisé individuellement ou en groupe (projets scolaires, étudiants ou associatifs). Les candidats ayant soumis les cinq meilleurs projets pourront les présenter et les soutenir devant un public international en novembre. Les 3 premiers recevront une dotation de la Région Bourgogne-Franche-Comté de 5000, 3000 et 2000 euros. Au préalable, il faut remplir le formulaire de candidature en ligne avant le 1er octobre. Voir tout

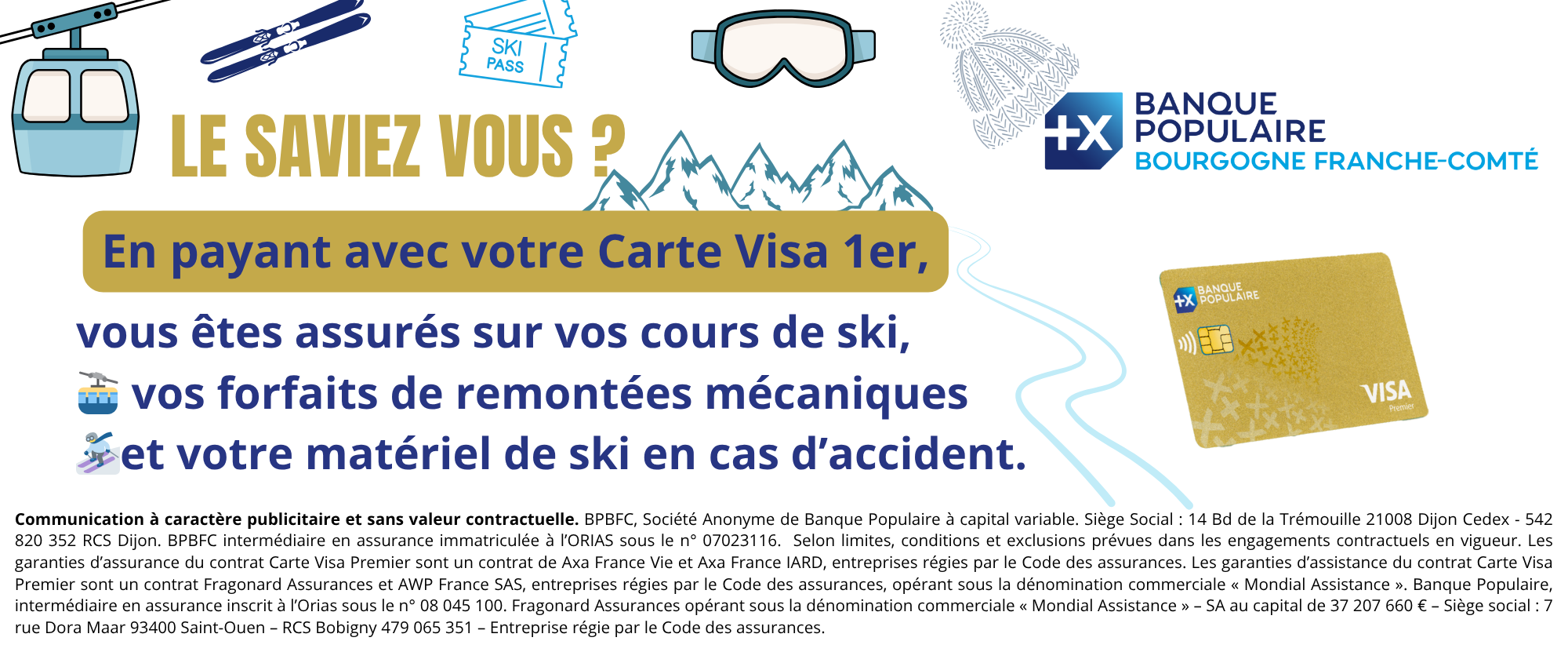
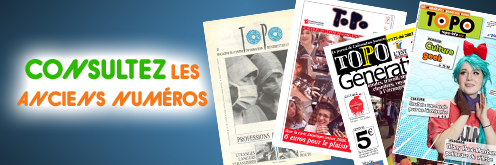




Commentaires
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.